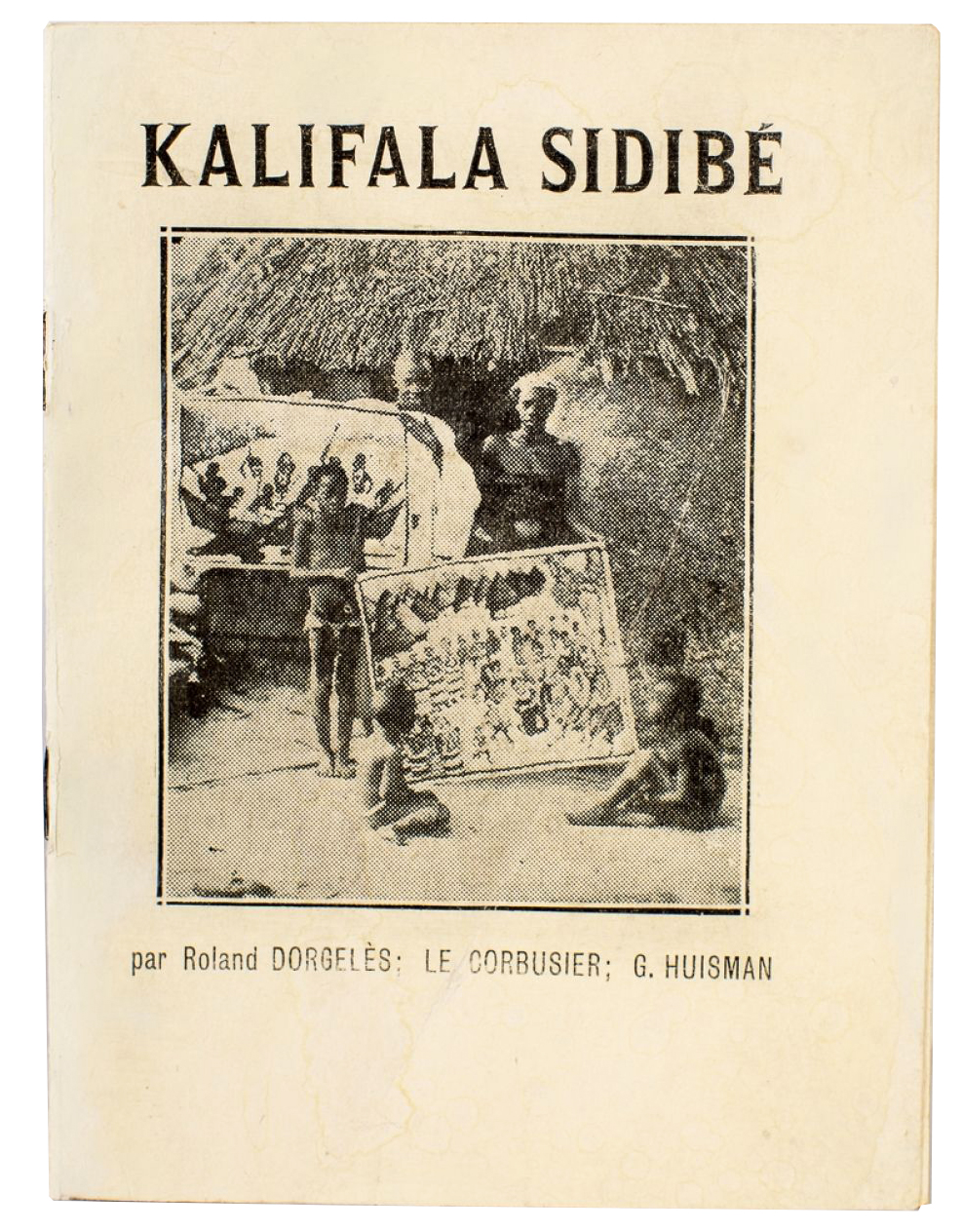C’était un opuscule de quelques pages, sans date ni éditeur. Il trainait au milieu de journaux et prospectus des années 30, dans la cave d’un pavillon dont je ne me rappelle pas le nom...
En couverture, une mauvaise reproduction d’une photographie « exotique » d’une famille africaine devant des toiles. En première page, un article de Roland Dorgelès intitulé « Kalifala Sidibé, peintre Soudanais » débutait sur cette terrible formulation : « j’aime les nègres ». Deux autres contributeurs participaient à ce surprenant petit catalogue d’exposition, Georges Huisman et Le Corbusier. Cette étrange réunion d’un peintre africain, d’un romancier, d’un critique d’art et d’un architecte ne laissait pas présager d’une œuvre capitale. Pourtant, 15 ans après qu’Apollinaire et consorts ont affirmé la puissance esthétique de l’Art Negre, une nouvelle révolution artistique, comparée à la Renaissance Italienne, se jouait dans ces quelques pages. Surnommé le Giotto africain, Kalifala Sidibé allait déchainer les passions et les haines à travers l’Europe intellectuelle et médiatique avant de disparaitre « saisi par la débauche » sans savoir qu’il venait d’ébranler un bastion idéologique de l’Occident : sa suprématie artistique.

Edition originale d'une insigne rareté du catalogue de la galerie Georges Bernheim consacré à l'exposition de Kalifala Sidibé, peintre malien, considéré comme le premier peintre africain sur toile, précurseur de l'Art africain moderne.
Textes de Roland Dorgelès, de Le Corbusier et de Georges Huisman, couverture illustrée d'une photographie du peintre dans son village.
Ce catalogue de la première exposition de Kalifala Sidibé qui fera ensuite le tour de l'Europe était jusqu'à aujourd'hui considéré comme disparu et parmi la cinquantaine de tableaux réalisés seulement deux sont actuellement répertoriés et conservés à la Fondation Le Corbusier et dans la collection de Michael Graham-Stewart.
L'exposition du 15 septembre au 3 octobre 1929 à la Galerie Georges Bernheim de ce jeune peintre africain eut un retentissement considérable dans le monde de l'art et au-delà dans la société parisienne. Les œuvres de Kalifala Sidibé furent ensuite exposées dans plusieurs galeries de renom dont Alfred Flechtheim à Berlin, la Neue Galerie à Vienne et le Gummesons Konsthall à Stockholm.
Une dizaine d'années plus tôt, Apollinaire et Paul Guillaume avaient déjà bousculé le regard porté sur « l'art nègre » cantonné jusque-là à une manifestation ethnographique plus ou moins esthétique. L'élévation de la statuaire africaine au rang d'œuvre d'art bouleversa la conception ethnocentrique européenne. Cependant, ces sculptures tribales conservaient aux yeux du spectateur un statut particulier : elles ne procédaient pas d'une volonté artistique. Si en 1929, l'Europe reconnait l'existence d'un art africain, celui-ci demeure un art sans artiste, comme le fut l'art roman avant Giotto.
Dès les premières lignes, Roland Dorgelès qualifie Kalifala Sidibé de peintre africain « authentique », en opposition à ces « noirs en veston », dont le talent artistique reconnu procède, selon la mentalité de l'époque, de leur occidentalisation. Parmi eux, les afro-américains Henry O. Tanner et Palmer Hayden, ou le nigérian Aina Onabolu sont des peintres respectés, « des évolués à peau d'ébène » qui « si [Dorgelès] les traitai[t] de nègres (…) se jugeraient offensés ».
Kalifala Sidibé « au contraire est le pur soudanais, le nègre sans mélange qui se nourrit d'igname, révère les crocodiles et fait sécher la viande sur le toit de sa case ». Son œuvre ne résulte pas d'un emprunt à l'occident mais de sa propre appréhension du monde et de son désir instinctif de « copier la nature ». Comparant implicitement les arts tribaux d'Afrique avec l'art médiéval européen, Dorgelès élève Kalifala au statut de Giotto africain, premier artiste d'un art qui n'est désormais plus primitif.
Cette Renaissance africaine annoncée repose en France sur ce seul artiste resté dans son village sur les bords du Niger. Les visiteurs de l'exposition ne verront de lui que des photographies représentant le peintre assis en tailleur devant sa toile, entouré d'enfants presque nus et d'une femme portant son bébé sur le dos tandis que sèche une précédente toile sur le toit de paille de la case. Cet exotisme digne des clichés du musée ethnographique du Trocadéro fera d'ailleurs couler plus d'encre que les peintures elles-mêmes.
Car, comme en 1916 lors de l'exposition des sculptures nègres aux côtés des œuvres de Picasso, Matisse et Modigliani, ce qui est en jeu avec l'exposition de Sidibé est moins la découverte d'un peintre d'exception que l'affirmation sulfureuse de l'universalité de l'Art et, plus encore, de son immanence : « à six siècles d'intervalle et sous d'autres cieux, c'est la merveilleuse histoire de Giotto qui se renouvelle. » La conséquence politique et éthique de ce constat est une remise en question de la hiérarchie raciale et du système colonial paternaliste.
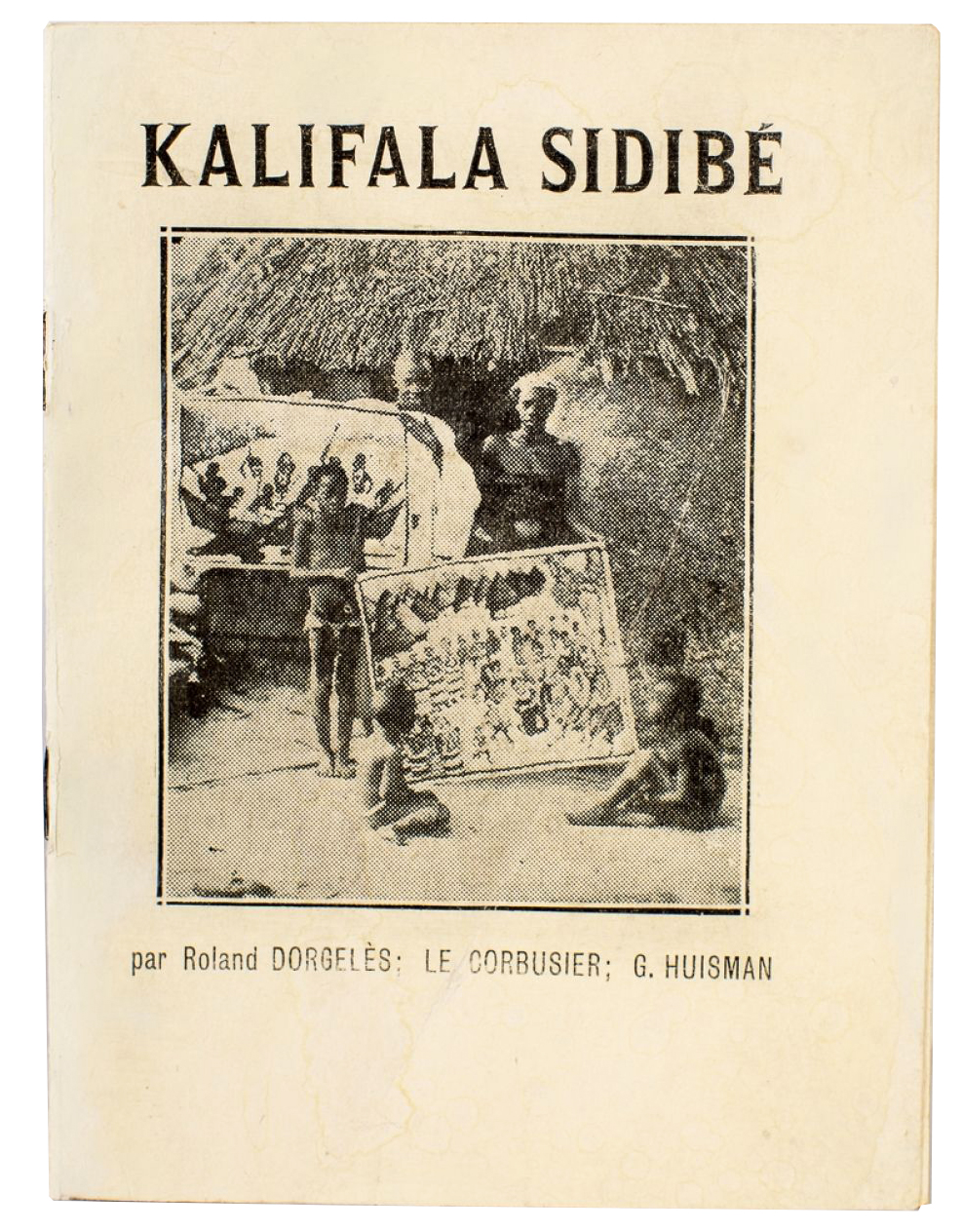
Une aventure artistique similaire est menée la même année en Belgique avec l'artiste congolais Albert Lubaki découvert par Georges Thiry et exposé au Palais des Beaux-arts de Bruxelles en septembre-octobre 1929. Cependant l'européen demeure à l'origine de la production artistique puisque c'est Georges Thiry, jeune administrateur colonial belge et commissaire de l'exposition qui, découvrant en 1926 les fresques sur cases de Lubaki, l'incite à travailler sur papier et le guide dans ses nouvelles réalisations (comme en témoigne leur longue correspondance avant l'exposition). Paradoxalement, cette intervention blanche, bien que vivement critiquée, assure la bonne réception de l'œuvre noire dans l'Europe colonialiste : l'œuvre de Lubaki servant de démonstration des « bienfaits émancipateurs » de la colonisation belge. Avec l'aide de Gaston-Denys Périer, Thiry renouvellera son expérience dès 1931 avec les œuvres de deux autres peintres de cases, Djilatendo et Antoinette Lubaki. Habiles, Périer et Thiry, promeuvent ainsi un « art nègre vivant » sous la coupe coloniale en louant : « les potentialités des indigènes évoluant sous notre administration ». « L'authenticité » mise en avant de Lubaki devient alors un simple argument commercial assumant sa part de construction exotique : « Avec votre agrément, Lubaki sera nègre d'Afrique, nègre cent-pour-cent, comme on dit aujourd'hui » (Carlo Rim,
Lubaki, peintre nègre, in Jazz n°11)
L'exposition de Kalifala Sidibé qui se déroule concurremment à Paris ne se prête pas à cette récupération. Ici, la « pureté » de l'africanité de l'artiste est un élément essentiel de sa présentation, comme en témoigne les innombrables articles de presse : « Ce peintre sénégalais est un véritable Sénégalais » (Paris-Midi, mardi 15 oct. 1929), « C'est un nègre, un nègre authentique » (Comœdia, jeudi 24 octobre 1929), « nègre authentique, qui vit sur les bords du Niger » (Le Quotidien, 16 oct. 1929), « un nègre authentique et primitif » (Vu, n 84, 23 oct. 1929),
A cet égard, l'histoire (ou peut-être la légende) de la découverte « instinctive » de son art par Kalifala Sidibé dans une factorerie cotonnière, grâce aux pièces de cotonnade et aux peintures utilisées pour la numérotation des sacs – discrète concession aux « bienfaits » collatéraux de la colonisation – contribue à construire un mythe fondateur d'une Renaissance « autonome » de l'art africain. De surcroit, cette indépendance artistique s'inscrit dans la mouvance avant-gardiste de l'art occidental comme le note, acerbe, un journaliste de
La Revue hebdomadaire : « Si l'on presse Kalifala Sidibé pour lui faire dire d'où vient son talent, il répond, parait-il : " C'est Diable qui faire manière comme ça… " Moins réaliste que surréaliste, ce nègre croit à la magie de l'art. Il est d'accord avec maint critique " avancé". » Une référence à peine voilée à la clique subversive conduite par André Breton.
Kalifala Sidibé n'ouvre pas seulement l'Afrique à l'Art - dans son acception moderne - mais à son expression la plus contemporaine. En pleine émergence de l'Art Naïf, du Surréalisme et bientôt de l'Art Brut, ce Giotto des Rives du Niger affirme innocemment l'indépendance de l'homme noir devant la plus haute expression de l'esprit humain.
Excitant les imaginaires, cette naissance « naturelle » d'une vocation artistique au sein de la brousse africaine explique en partie l'agitation médiatique autour de cet artiste inconnu.
Des
Annales Coloniales à
Paris-Soir, l'exposition est relayée par presque tous les quotidiens et nombre de journalistes s'improvisent critiques d'art pour déverser sur cet idéal bouc émissaire leur ressentiments à l'égard de l'art moderne, Le douanier-Rousseau en tête, et de la dite négrophilie des élites artistiques. « Kalifala est une sorte de Rousseau nègre, avec cette différence que le douanier rêvait d'imiter les tableaux du Louvre, tandis que lui ne pense qu'à imiter la nature. Voilà une qualité il me semble. Hélas ! J'ai grand peur qu'on ne la lui fasse perdre bientôt ! on a déjà gâté de la sorte un marchand de pomme de terre frites, un homme de peine et une femme de ménage dont les œuvres font la fortune des marchands. »
L'article de René-Jean dans la revue
Comœdia du 24 Octobre 1929 est sans doute le plus emblématique du terrible enjeu de cette peinture moderne extra-occidentale :
« Si l'on exalte ce nègre, c'est qu'il est malaisé de porter sa peinture au pinacle. Peinture… le mot peut être est excessif au sens que nous lui donnons en général. Les tableaux de Kalifala Sidibé sont de grandes images coloriées (…) sans souplesse ni nuances. Certains manuscrits abyssins nous montrent des frises assez semblables avec leurs personnages qui se suivent à celles de Kalifala Sidibé. »
Malgré ce constat qu'il veut définitif, René-Jean, critique d'art estimé, ne consacre pas moins de sept colonnes à cette exposition d'un artiste qu'il juge si sévèrement. Et c'est à grand renfort d'artistes français classiques et modernes qu'il tente de repousser l'idée d'un art africain. Delacroix, Puvis de Chavannes, Poussin, Watteau, Corot, Daumier, Baudelaire, Rabelais, La fontaine, Voltaire, Racine, Mozart, Renoir, Courbet, Cézanne, Vlaminck, Matisse, Houdon, sont tous invoqués dans ce seul article pour étouffer dans l'œuf l'inconcevable prétention du continent africain. Et René-Jean de refuser à l'Afrique jusqu'à la représentation d'elle-même : « [Le XVIIIe siècle] n'a pas ignoré la Race noire. S'il n'a pas cherché chez elle des maitres à glorifier, il lui a emprunté certains types qu'il prit comme modèles. A ses deux extrémités, Watteau comme Houdon ont (…) créé des types plus spirituels tout de même que ceux de M. Kalifala. Osera-t-on dire qu'ils sont moins vrais ? Voilà qui ne serait pas flatteur pour les hommes à la peau noire. »
La violence des propos n'a d'égale que le séisme provoqué par cette exposition qui remet en question la suprématie autoproclamée de la race blanche.
Si plusieurs critiques attestent avec Le Corbusier de l'incroyable talent de Sidibé, c'est avec la tentation de le priver de cette « authenticité » si problématique : « Eh bien ! celui-là même en sait trop long ! Ce n'est pas l'ingénuité de ses bariolages qui nous charme. Ses étoffes rayées font songer aux fonds de Matisse. Et puis, il a ce que les peintres d'Occidents ont travaillé des siècles avant d'acquérir : le sentiment de ce que Berenson appelle les
valeurs tactiles. Kalifala Sidibé (…) dessine avec abandon, avec la désinvolture du « génie ». (In La Revue hebdomadaire)
Ce talent incontestable est alors attribué aux persans dont « on peut même se demander si dans quelque coin de sa case Kalifala Sidibé ne conserve pas [quelques] images. » Mais c'est encore une fois les implications philosophiques et éthiques plus que le peintre qui sont ici violemment niées : « Est-ce vraiment « le besoin de copier la nature » qui le tourmente ? Et ce besoin, d'ailleurs, est-il à l'origine des premières manifestations artistiques de l'humanité ? ». (In La revue hebdomadaire, 9 novembre 1929).
Cette interprétation n'est d'ailleurs pas le fruit de l'animosité ethnique d'un journaliste. La violente charge de La revue hebdomadaire n'est en effet que la réécriture d'un article laudatif du
journal des débats politiques et littéraires paru 10 jours plus tôt :
« Les peintures de Kalifala Sidibé sont extrêmement séduisantes et ne charment pas seulement par leur gaucherie, leur naïveté. On serait presque tenté d'ajouter : Au contraire ! Il y a dans cet art une liberté d'écriture qui surprend chez un homme qui, paraît-il, n'a jamais vu de peinture européenne. Certaines étoffes rayées font penser aux fonds de Matisse. Et le nègre, du premier coup, réussit à « faire tourner » un bras, par exemple, alors que les dessinateurs d'Occident ont mis des siècles à découvrir Ce que M. Berenson appelle les « valeurs tactiles ». (…) Ne s'est-il pas inspiré du folklore oriental, asiatique, plus que de la nature même ? »
L'insistance sur l'inspiration orientale de Sidibé s'appuie sur une déformation du texte de Le Corbusier qui suppose en effet, dans notre catalogue, une généalogie orientale à l'ethnie de Kalifala. Cette supposée origine Indo-asiatique : « Ce nègre me fait l'effet d'appartenir à des races qui eurent contact avec les Persans et les Hindous » est tout simplement réinterprété » par les journalistes en conviction d'une imitation de l'Orient.
Qu'ils soient complaisants ou virulents, les nombreux articles suscités par cette exposition s'articulent presque tous autour de la négritude de l'artiste et, par-là, de la négrophilie dite « en vogue ». Ils n'esquivent pas de la sorte la question artistique, ils soulignent inconsciemment que l'enjeu véritable de cette exposition est plus politique qu'esthétique.
« Le temps est au noir » ironise ainsi Gabriel Joseph Gros en ouverture de son article du Paris-Midi. La préface même que consacre Dorgelès à cette exposition s'ouvre par un « J'aime les nègres » et ne s'articule qu'autour de cette thématique, se soustrayant ostensiblement à la question de la qualité artistique : « Le nom de cet inconnu deviendra-t-il célèbre ? Mon amour des nègres me pousse à le souhaiter ».
Seuls Le Corbusier et Michel Leiris prennent la mesure de la puissance intrinsèque de la peinture de Kalifala Sidibé et dévoilent sous les implications politiques, la question métaphysique posée par cet art renaissant.
Le Corbusier en premier lieu, propose dans le catalogue de l'exposition une grille de lecture qui ne trouvera aucun écho, et pour cause, dans la presse de l'époque : il compare la peinture de Kalifala à une écriture, « des signes clairement dessinés qui se lisent et peuvent provoquer par leur disposition des rapports pleins d'intérêt et de signification. (…) créer des signes, représente une puissance de synthèse et des vues claires. (…) En quoi nous intéresse ce noir inculte ? Il écrit picturalement. (…) et il atteint à quelque chose de fixe, à du définitif : ce sont des
peintures et elles ne sont ni modernes ni anciennes. ». Par ce refus d'inscrire l'œuvre de Sidibé dans la continuité de l'art tribal, Le Corbusier ne mesure pas l'artiste à l'aune de sa négritude, mais du concept universel d'Art.
Une conception que partage le jeune Michel Leiris qui stigmatise dans
Documents n°6 « l'échelle de valeur arbitraire » établie par « la race blanche » et la « pureté de style qui obnubile tant d'esprits ». Un an avant son voyage en Afrique, l'exposition de Kalifala Sidibé inspire au futur auteur de
L'Afrique fantôme une réflexion qui « allait influencer ses recherches ethnologiques qui refusent la vieille interprétation ou la stylisation schématique et simple des arts africain » (Yanagisawa Fumiaki, La naissance du tableau en Afrique noire : Kalifala Sidibé et l' « art nègre »)
Malgré les critiques, cette première exposition est une réussite et sera suivie de plusieurs autres en Allemagne, puis à Stockholm, sans que l'on sache exactement combien d'œuvres seront présentées et vendues.
Un an plus tard, alors que s'ouvre une nouvelle exposition de ses toiles à la galerie Gerbo à Paris, Kalifala Sidibé, à peine âgé de trente ans, meurt, prétendument « saisi par la débauche » résultant du succès européen (Comœdia, 23 novembre 1930). Son talent est alors reconnu par tous et ses œuvres acquises par des collectionneurs à travers toute l'Europe. Mais sa disparition prématurée met un terme à cette toute première aventure africaine de l'art moderne. Le catalogue d'exposition de la galerie Bernheim, fragile plaquette réunissant pourtant trois grandes plumes, était jusqu'à présent considéré comme perdu à l'instar de la grande majorité de ses œuvres produites et attestées par les catalogues d'expositions européens. Il ne demeure aujourd'hui que deux toiles connues : dans la galerie londonienne Michael Graham-Stewart et à la fondation Le Corbusier. On ne possède des autres peintures, toutes signées en arabe, que quelques témoignages en noir et blanc d'époque.
On peut raisonnablement questionner l'étonnante occultation de l'Histoire de l'art de cet artiste qui connut les honneurs des plus prestigieuses galeries d'art moderne du début du XXème, foyers de l'avant-garde artistique : La galerie Georges Bernheim à Paris où furent notamment exposés Bonnard, Vuillard, Cézanne, Seurat, van Dongen, Matisse, le Douanier Rousseau, Dufy, Vlaminck, Modigliani et Utrillo ; la galerie Alfred Flechtheim à Berlin qui mit à l'honneur Picasso, Braque et Derain, le Gummesons Konsthall à Stockholm qui exposa très tôt Kandinsky, Klee, Munch et plus tard Andy Warhol ou la Neue Galerie à Vienne. Immortalisée par une photographie de Brassaï, une scène de chasse acquise par Le Corbusier trôna longtemps au-dessus de son bureau. Cette toile est aujourd'hui exposée à la Fondation Le Corbusier.
La longue étude que lui consacre Yanagisawa Fumiaki, docteur ès lettres à l'Université de Tokyo, spécialiste des arts africains en Europe et du modernisme dans la culture africaine sub-saharienne, met en lumière « la situation inextricable interne à la réception des cultures noires en France à la fin des années 20 » qui, avec la trop brève carrière de Kalifala Sidibé et la disparition de ses toiles, explique en partie l'effacement progressif du premier peintre moderne de l'Histoire de l'Art africain !
>>Voir la fiche complète
***








![[Meidosems] Sans titre. Encre et aquarelle](media/crop1-h-177-w-165-michaux_henri_sans-titre-encre-et-aquarelle_1946_edition-originale_5_64945.jpg)